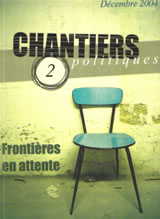|
CHANTIERS : « On établit des chantiers pour y déposer et travailler le bois et la pierre d'un bâtiment en construction » LITTRÉ |
La frontière, limite géographique, séparation entre deux lieux, est aussi en elle-même un lieu, un espace palpable, concret, qui peut prendre la forme de zones d’attente, de douanes ou de centres de rétention. La coupure entre deux « mondes » n’est pas une ligne invisible ou abstraite, mais un lieu d’attente, de passage et de différenciation. C’est à ce type de frontières, à la fois réalité juridique et matérialisation des contrôles et passages que nous avons voulu nous intéresser. Car ce sont elles qui sont des « chantiers », des lieux de réformes privilégiés, sous l’effet des transformations du droit d’asile et du droit d’immigration, des conflits et des évolutions socioculturelles liées à la globalisation en cours. Les frontières sont actives et passives : transformant le monde d’un côté, en constante évolution sous l’effet de la transformation du monde d’un autre. Depuis le temps des pionniers, celui où s’est élaboré le mythe américain de la frontier, l’ensemble des terres habitables a été découvert, et si la face du monde n’en a pas été changée, du moins elle s’est fait connaître dans sa totalité. Le temps des conquérants est révolu. Moins que de repousser la frontière, il s’agit, pour les États et les individus d’aujourd’hui, de la franchir, de la négocier, de la renforcer, de l’amoindrir et parfois de la supprimer. Dans ce numéro, nous verrons comment, entre deux lieux communs sontradictoires de disparition des frontières sous l’effet de la mondialisation et de résurgence du protectionnisme migratoire, se redéfinissent les frontières : lieux de passage et d’échange ou clôtures ? Elles sont une des réalités actuelles les plus révélatrices sur l’état des relations internationales. D’un côté, l’idée de village planétaire semble largement illusoire et les frontières ne disparaissent pas. Le « droit mondial », que Mireille Delmas-Marty appelle de ses voeux, se heurte encore à des frontières résistantes. D’un autre côté, cette résistance ne doit pas nous faire négliger la positivité d’un accroissement considérable des échanges inter frontaliers, au niveau économique d’abord, mais aussi au niveau culturel et humain. C’est cette ambivalence de la frontière qui nous a semblé intéressante, et qui nous a permis de voir la frontière comme un lieu en attente, comme un lieu toujours en réforme et à réformer. Partant du rôle fondamental de l’homme dans la détermination et la « protection » des frontières, nous nous sommes demandé non seulement « qu’est-ce qui change dans les frontières ? », mais aussi « que changer dans les frontières ? ». Nous sommes donc partis de la frontière comme séparation pour arriver à la frontière comme vecteur, en passant par la frontière comme héritage créateur d’identité et de culture originale. Le premier dossier interroge la concrétude des frontières, ce que signifie « passer la frontière » comme action réelle : comment fait-on pour franchir une frontière quand on est en-dehors, de « l’autre côté » ? Quelles sont les matérialisations de la frontière, ses « incarnations » ? Les articles et les entretiens sur les nouveaux modes de contrôle aux frontières révèlent les effets pervers d’une fermeture renforcée. La situation de ceux qui sont en attente à la frontière stricto sensu, c’est-à-dire dans cette zone de non-droit qui n’est ni l’intérieur, ni l’extérieur, illustre parfaitement la manière dont la frontière peut devenir un lieu concret et visible. Ces « lieux » se multiplient, en France avec les zones d’attente, en Italie avec les centres de rétention et en Europe où l’on débat de la création de camps de réfugiés, de « portails d’immigration » situés hors de l’Union pour trier les migrants. Les frontières sont aussi en attente lorsque la détermination de leurs tracés et de leurs définitions constitue l’enjeu de négociations (« Frontières en Héritage »). C’est par exemple le cas au Tibet, où une forte identité culturelle et religieuse pousse les tibétains à revendiquer la transformation de leurs frontières administratives internes à la Chine en véritables frontières internationales. Ici, c’est l’héritage de frontières culturelles et identitaires qui entraîne une contestation des frontières actuelles2. Le mouvement entre frontière-symbole et frontière-tracé peut aussi se faire en sens inverse : c’est par exemple le cas en Allemagne où la partition de l’après-guerre a laissé des traces qui survivent à la chute du mur. Le mur séparant l’ex-RDA du reste du monde occidental a contribué à la création d’une identité est-allemande, montrant à quel point frontières et identités sont liées, même lorsque l’existence de la frontière n’est l’objet ni d’attentes, ni de revendications. Il ne s’agit alors plus de réformer, mais de reconnaître la valeur de la frontière comme symbole après sa disparition comme tracé. Il y a des lieux qui sont en attente de frontières (« Chantier dans le ciel ? »), des lieux hors du monde où la frontière redevient « frontier ». Dans 2 Nombreux seraient les exemples de frontières contestées du fait d’une inadéquation entre ce qu’elles représentent comme héritage identitaire et ce qu’elles délimitent comme entité politique (conflit israélo-palestinien, Irlande du Nord, Cachemire…), mais nous avons choisi de ne pas étudier les conflits internationaux liés aux frontières qui auraient mérité un numéro à part entière. l’espace, les débats sont comme épurés par l’absence de toute référence à des frontières « naturelles ». A travers un dialogue imaginaire et un entretien réel, l’auteur du dossier s’interroge sur les limites d’un lieu apparemment sans limites et sur la manière dont l’exploitation des ressources spatiales fait du ciel un enjeu politique et juridique majeur. Il existe enfin des attentes positives :la frontière n’est pas seulement un lieu d’attente et de fermeture invitant à des réformes pressantes, mais aussi un lieu de passages et d’échanges. Ainsi, les réformes engendrées par l’approfondissement de l’Union Européenne contribuent à un effacement des frontières intérieures et à la naissance d’un espace médiatique européen qui, s’il est encouragé par des mesures politiques volontaristes, permettra l’émergence d’une nouvelle forme de citoyenneté (« La sphère publique européenne en mal de médias »). Alors que, dans le cas du Tibet, le sentiment d’identité culturelle est à l’origine des revendications de frontières, dans le cas de l’Europe, c’est la redéfinition des frontières qui est à l’origine d’une nouvelle forme de citoyenneté. C’est aussi de frontière-passage qu’il s’agit dans le développement des saisons culturelles comme nouvel instrument de la diplomatie culturelle internationale ; la pratique des années croisées montre l’importance parallèle de l’accueil de la culture de l’autre et de la diffusion de sa propre culture (« Saisons culturelles, une diplomatie de l’échange »). Des entretiens sont venus éclairer ces questions auxquelles non seulement les États, mais aussi les individus (des jeunes Allemands de l’Est), les associations (Anafé, Amnesty International, l’Association française pour le développement du droit de l’Espace, Pollens) et les organisations internationales (OSCE) ont des réponses à donner, en attendant la « construction d’un droit commun de l’humanité » dont Mireille Delmas-Marty entrevoit le dessin. |